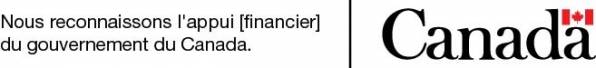La mort tragique d’un nouveau-né retrouvé dans un abribus à Longueuil a frappé l’imaginaire. Pour Catherine Flynn, elle est l’«aboutissement d’un paquet d’exclusions, de situations vécues par cette mère, qui ressemblent à des situations vécues par plein d’autres femmes». Des parcours marqués par la violence, la stigmatisation et des soins de santé qui leur sont inaccessibles.
«Oui c’est bouleversant, mais il n’aurait pas fallu qu’on attende le décès de ce bébé pour s’inquiéter de la santé des mères, de la santé des femmes, de leur bien-être et leur sécurité», explique la chercheure principale de l’étude «Itinérance des femmes en Montérégie – Un portrait régional pour mieux répondre aux besoins».
Mme Flynn s’intéresse aux femmes en situation d’itinérance depuis son mémoire de maitrise. Elle connait leur réalité. Cette triste histoire qui a fait les manchettes en octobre n’a donc à ses yeux rien d’un cas isolé. Elle constitue «le produit d’un système qui craque de partout».
La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) et la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS) y voient le symptôme d’un échec collectif de protéger les femmes les plus vulnérables.
Ces regroupements ont approché Mme Flynn pour lancer une recherche visant à comprendre les besoins des femmes ayant vécu ou vivant en situation d’itinérance en Montérégie, ou qui sont à risque de la vivre. Les deux Tables sont partenaires de la recherche.
«On voit que les besoins sont criants. Les intervenants sur le terrain observent de plus en plus que les femmes vont et viennent dans les ressources, qu’elles vivent de plus en plus de situations de précarité dans leur logement, accentuées avec de mauvaises conditions de santé, de violence aussi.»
Les ressources pour personnes en situation d’itinérance sont hautement sollicitées et les refuges pour femmes sont pleins. Mme Flynn donne en exemple une femme de la région qui s’est retrouvée seule avec 19 hommes dans un refuge.
La recherche qualitative s’appuie ainsi sur la parole des femmes : 38 ont été rencontrées et ont raconté leur parcours. L’équipe espère recueillir une soixantaine de témoignages.
Stigmatisation
Qu’est-ce qui marque l’itinérance au féminin?
Au fil des recherches qu’elle a menées depuis 2010, Catherine Flynn a rencontré plus de 200 femmes qui lui «ont fait don de leur histoire de vie». La violence, sous plusieurs formes, demeure au cœur de leurs situations.
La professeure à l’unité d’enseignement en travail social du Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi parle aussi de violence institutionnelle.
«Elles sont toujours engagées à recréer des liens sociaux. Elles fréquentent les ressources, demandent de l’aide, sont mobilisées, débrouillardes, mais elles sont stigmatisées, constate-t-elle. Dès qu’elles ont un comportement un peu à côté d’une femme douce, gentille, conciliante, elles sont reçues différemment. Elles sont en colère contre le système, et avec raison : elles se butent à de nombreux obstacles.»

L’un des constats préliminaires ressortant de la collecte de données en Montérégie, ce sont les nombreux et graves problèmes de santé, bien souvent non traités. En filigrane de l’accès difficile aux soins se trouve cette stigmatisation dont elles sont victimes.
«On a des femmes qui se rendent à l’urgence, mais n’ont pas accès à des médecins et se font sortir par des agents de sécurité. Elles sont en état de consommation et sont critiquées, décrit Mme Flynn. On est beaucoup dans une logique de responsabilisation individuelle face à notre santé. Donc les femmes se font souvent blâmer, reprocher d’avoir eu une conduite à risque ou d’avoir couru après le trouble. Ça fait des années que ce genre de situations m’est raconté.»
Elle donne en exemple une femme qui n’a pu être soignée à l’hôpital après avoir été victime de brutalité policière. «Dès qu’elles ont des éléments associés à la pauvreté, ou qu’elles ont une attitude résistante, ce sont des éléments qui amènent des biais, conscients ou inconscients, qui font qu’on les considère avec moins de dignité.»
Une telle exclusion entraîne des répercussions sur leur santé, leur sécurité et leurs possibilités de réinsertion sociale.
Les témoignages démontrent aussi des ruptures dans la trajectoire de soins. Des femmes se retrouvent sans soutien en sortant d’une hospitalisation, ou encore au terme d’un parcours en protection de la jeunesse.
Autre spécificité de l’itinérance chez la femme : la maternité.
Si les injonctions auxquelles doivent se conformer l’ensemble des femmes face à la maternité sont fortes, la charge mentale «n’a aucune commune mesure» pour celles en situation d’itinérance qui sont enceintes ou qui ont des enfants en bas âge.
Générosité
Jusqu’à maintenant, les femmes rencontrées viennent d’un peu partout en Montérégie. «On ratisse assez large, pour documenter les inégalités territoriales», relève la chercheuse. Selon la tendance actuelle, il y davantage de femmes plus âgées.
L’équipe de six chercheuses et intervenantes s’inquiète toutefois de l’échantillon peu diversifié en matière d’origines ethnoculturelles. «C’est peut-être un résultat de recherche en soi, mais ça nous préoccupe de ne pas avoir ces voix suffisamment représentées. Elles vivent du racisme systémique, vivent des obstacles dans une plus grande mesure, on se demande où elles sont.»
Si elles sont d’abord méfiantes, les femmes rencontrées s’ouvrent avec générosité sur leur vécu. «Elles sont surprises à quel point ça peut leur faire du bien de constater tout le chemin qu’elles ont parcouru et comment elles sont encore capables de tenir debout», relate la co-responsable du Pôle violence du Réseau québécois en études féministes.

Malgré les années d’expérience, Mme Flynn est toujours touchée, indignée, bouleversée par ce qu’elle entend.
«Je suis toujours surprise de la proportion de femmes qui ont des enjeux de santé physique majeurs, pour lesquels il n’y a pas de suivi ou prise en charge. Mais plus j’avance, moins il y a de choses qui me surprennent. Je suis encore impressionnée par la résilience et le courage de ces femmes.»
La collecte de données doit s’échelonner jusqu’à la fin de l’année et sera suivie de l’analyse. Les résultats seront dévoilés à l’automne 2026.
Solutions
La TIRS et la TCGFM réclament des actions concertées pour renforcer les mécanismes de soutien et d’accompagnement auprès des femmes en situation de précarité.
Selon Catherine Flynn, il est essentiel d’offrir de l’hébergement sécuritaire donnant une stabilité à long terme. Elle déplore que trop de ressources limitent les séjours à une ou trois nuits, de sorte que les femmes se promènent constamment d’une ressource à l’autre.
Les femmes devraient aussi bénéficier d’un accompagnement dans leurs relations avec les divers milieux de santé, de services sociaux, avec les policiers. «Ça ressort en termes de pistes de solution, de s’assurer que les gens se parlent et qu’il y ait un lien entre les acteurs», soutient-elle.
Elle nomme aussi la lutte contre la stigmatisation. «On dirait que l’aide est offerte au mérite, que les femmes doivent montrer qu’elles se prennent en charge et font des démarches, pour obtenir de l’aide ou du soutien. [Il serait important] d’accepter les gens de manière inconditionnelle, là où ils sont dans leur processus.»